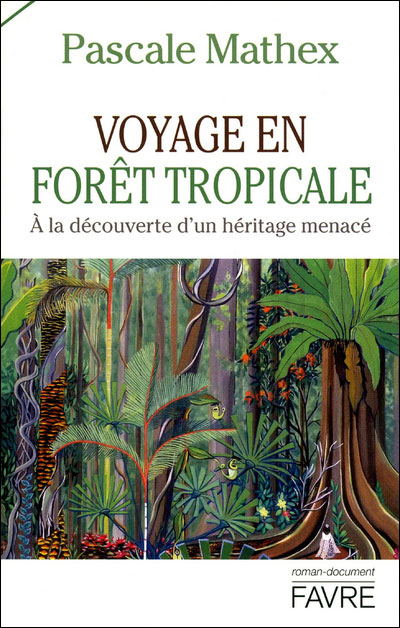J’ai publié Voyage en forêt tropicale aux éditions Favre en octobre 2011.
A la fois roman «végétal », document scientifique, et conte philosophique, Voyage en forêt tropicale est le chant choral des milliards d’espèces végétales et animales de la forêt tropicale humide, que nos petits-enfants ne connaîtront jamais. C’est le chant désespéré d’Hélène, de Marianne van Terland, de Yann Smith, des Dusuns et des Penans. Hélas, depuis la publication de cet ouvrage, j’assiste toujours impuissante à la destruction accélérée des forêts tropicales humides de la planète.
Nous payons aujourd’hui très cher notre arrogance et notre manque de respect pour le vivant que Mark Twain dénonçait déjà en son temps. Destruction des écosystèmes, élevage et agriculture intensifs, nous avons franchi toutes les limites de l’innommable et nous sommes arrivés à un point de non retour!
Je pense chaque jour aux jeunes générations qui héritent de ce pathétique désastre. Une révolution totale des politiques économiques et des comportements est indispensable si nous voulons renaître de nos cendres.
Pascale Mathex
QUELQUES EXTRAITS
pour les amoureux des forêts…
Lever du jour sur la forêt tropicale
La forêt encore compacte et sombre émergea du long filet de brume, qui se confondait parfois avec le couvert nuageux particulièrement bas. Une lumière douce et rose s’élevait de l’horizon et colorait les nuages les plus bas, tandis que les cimes des arbres baignaient dans une vapeur blanche, opaque, apaisante. Un phénomène étonnant se produisit alors. Hélène vit de ses yeux la brume volontairement s’élever, se teinter de rose et de mauve, se disperser, et révéler la forêt dont l’abondante végétation à son tour rosissait avant d’afficher un vert plus net et bientôt lumineux. En même temps que la brume s’était étirée pour disparaître, les nuages s’étaient illuminés, puis élevés en altitude pour ne devenir que de fines traînées dans un ciel bleu clair aux éclats dorés. La canopée était alors éclairée d’une lumière brillante aux reflets pastel. Les dernières nappes de brumes s’attardaient dans les dépressions, retenues par la fraîcheur de la terre. Une demi-heure plus tard, il ne restait plus rien de la nuit. La forêt brillait au soleil des tropiques. Il était sept heures du matin.
Le figuier étrangleur
Un jour, une graine s’était déposée à mi-chemin entre la terre et la lumière. Elle avait fini sa course à la naissance d’une branche, très haut, presque à la canopée, et avait décidé d’y germer, abreuvée d’humidité, bien installée sur un nid de mousse et de feuilles décomposées. L’hôte était superbe, un arbre gigantesque et fier qui depuis des siècles se frayait un passage parmi ses congénères. Son tronc filait à la verticale, majestueux, dur comme le marbre, jusqu’à la voûte épaisse où s’étalaient alors ses branches et frémissaient ses feuilles ivres de clarté. Pour lui commençait alors le compte à rebours. Plus tard, un géant magnifique, au tronc multiple, divisé, torsadé, au corps onduleux, puissant, extravagant dans l’ingéniosité de ses ramifications, imposant par la force de ses racines convulsives, et terriblement satisfait de sa débauche, avait pris la place de celui qui, un jour, lui avait humblement offert un abri pour germer. L’antique et discrète présence restait pourtant, en creux, comme une marque à la craie de la silhouette d’une victime dont on a retiré le corps, car le figuier étrangleur avait pris la forme exacte de celui qu’il enserrait jusqu’à l’étouffer, jusqu’à sa mort, ne laissant qu’un grand vide, une trace en négatif, la mémoire de lui-même, et le deuxième arbre portait en lui le fantôme de celui qui lui avait servi de socle, de support, de béquille, et qui lui avait permis d’être avant de disparaître. Les racines aériennes, devenues de vrais troncs, parfois plongeaient droit jusqu’au sol, parfois faisaient mille circonvolutions, déviées dans leur course par d’autres racines, d’autres lianes, et l’abondance de courbes, de spirales, de boucles, étourdissait au point qu’il était devenu impossible de se repérer dans cet enchevêtrement.
Les Nepenthes
Il s’était arrêté. Au sol, devant eux, un défilé de soldats casqués se tenait planté dans le sable, au garde-à-vous, pour leur barrer le chemin. Minuscules pichets, pour la plupart desséchés, les Nepenthes s’apprêtaient à les faire trébucher, pour les empêcher d’aller plus loin. Hélène sourit. Ils suivirent les plantes rampantes jusqu’au sous-bois. Les fins pichets vert clair tachetés de rouge, légèrement renflés à la base, étaient coiffés d’un chapeau rougeâtre les protégeant du soleil. Au pied des premiers arbres, les défilés se transformaient en cohortes, en légions, en débandade. Des Nepenthes de toutes sortes foisonnaient et s’épanouissaient dans la plus totale liberté. Hélène fut subjuguée. Au sol, de petites urnes rondes se multipliaient en bouquets circulaires, tantôt d’un vert tendre uniforme, tantôt d’un vert jaune grêlé de rouge. D’un côté de l’urne, deux petites languettes poilues s’enroulaient parfois sur la tige qui n’était qu’une extension de la feuille, ou bien s’ouvraient comme deux larges pétales. Mais ce n’était pas tout. Plus Hélène s’enfonçait sous les feuillages, plus la taille des urnes augmentait. Elle en trouva d’aussi grosses qu’une tasse à thé, d’un vert presque blanc, affublées d’un col rouge sombre, d’autres d’un vert brillant doré au col jaune et coiffées d’un couvre-chef orangé décoré d’un petit crochet rouge. Toutes étaient remplies d’un liquide transparent comme de l’eau mais légèrement plus visqueux, dans lequel flottaient des débris d’insectes morts, et d’autres vivants qui se débattaient avant de succomber. De nombreuses fourmis se promenaient sur les plantes et semblaient être les principales victimes de ces pièges. Sur un tapis de feuilles mortes, à l’abri du soleil, Hélène découvrit de grosses urnes, rouges à l’extérieur et vert tendre à l’intérieur, brillantes et polies, confortablement posées comme des poupées russes sur un napperon. Puis, levant les yeux, elle s’extasia devant de longs pichets de toutes formes et de toutes couleurs qui pendaient, comme des boules de Noël accrochées au sapin, aux branches des arbustes auxquels s’étaient mêlés les Nepenthes grimpants. Pichets parfois cylindriques, parfois en forme de cornets allongés, parfois blanc crème, vert bronze ou bleuté, parfois presque dorés. Les plantes poussaient alors en hauteur, et de la tige principale, chaque longue feuille, courbée par le poids du pichet, se terminait par une extension qui faisait une boucle, pour enfin se redresser sous la forme de cette extraordinaire flûte en forme de calumet, bercée par les mouvements de l’air. Hélène examina de plus près un jeune pichet vert comme un bourgeon de printemps. Il n’était pas encore ouvert. Le chapeau était scellé au col, les deux languettes poilues enroulées sur elles-mêmes. Elle s’émerveilla devant les urnes les plus élégantes et les plus allongées des Nepenthes grimpants, qui se balançaient vraiment très haut dans les branches et dont le col vert était étiré et rayé de rouge comme le col d’un vêtement de haute couture. Ce furent des heures d’extase et de fascination. Hélène en oublia tout, jusqu’à sa propre présence au cœur de ce paradis végétal. Que dire de plus? Que penser de plus? N’avait-elle pas tout vu, tout pensé, tout découvert?
La forêt expliquée
La forêt expliquée semblait à Hélène de plus en plus familière. Yann connaissait aussi tout des mousses et des lichens, des algues, des fougères, des orchidées et des gingembres. Il pouvait nommer les champignons: Cookeina tricholoma, Rigidiporus lineatus, Lentinus connatus, Lentinus velutinis, Strobilomyces, Mycoporus xanthopu.
– Les champignons ne possèdent pas de chlorophylle et se nourrissent d’êtres vivants décomposés ou vivent en parasites sur des plantes, disait-il. L’ombre et l’humidité des sous-bois leur conviennent à merveille. Yann savait les identifier, exactement comme Marianne T. savait reconnaître à leur chant le barbu à tête rousse, la commère à ailes brunes, l’engoulevent malais, le bulbul, la timalie, la perruche, le drongo de paradis, la corneille à bec mince, le coucou, le coucal, le couroucou, le calao ou la pie de Malaisie. Elle connaissait même leur nom latin. C’était à peine concevable. Hélène savait bien reconnaître le vol du calao et le cri du gibbon qui hurlait «Owa Owa », mais elle ne parvenait pas à distinguer les chants des oiseaux. Voyage en forêt tropicale 135 Hélène avait par contre identifié sans peine Cyrtostachys renda, Ixora javanica, Tacca integrifolia, Hornstedtia scyphyfera, Ficus religiosa, Archidendron ellipticum, Mimosa pudica, Platycerium, Melastoma malabathricum, Dillenia suffruticosa, Cinnamonum iners, et bien d’autres dont sa préférée, Gloriosa superba. Mais elle ne savait que faire de tous ces noms. L’existence des noms ne changeait en rien l’existence ou la non-existence du végétal. Les noms n’étaient que des conventions, des constructions de l’esprit, exactement comme le concept de temporalité chrétien. L’homme a besoin de références pour comprendre le système qui l’entoure, mais le système est, par-delà la compréhension de l’homme. L’homme ne parle que du système qu’il comprend, et croit que mettre des noms sur les choses leur donne une réalité. Il n’a pas de mot pour ce qu’il ne comprend pas. C’est à ce stade que l’homme, abandonnant tout concept, cherche dans l’art. Et si cet art est l’art des mots, ces mots deviennent des mots qui ne nomment pas. «Cependant l’art, se dit Hélène, n’est pas le privilège des mots. » Elle pensa une fois de plus à la Danse, à ce rythme absolu, à cette cellule rythmique, celle de la plante grimpante qui répète cette structure identique, d’un côté, puis de l’autre, pour se rapprocher, autant que cela se peut, de la lumière. Le rythme de l’arbre qui, en se répétant, se démultipliant, dans un calme absolu, s’épanouit jusqu’à l’éblouissement. Hélène pensa : «La Danse, c’est le fonctionnement de l’arbre, c’est la pensée débarrassée de tout nom. »
– Chaque arbre, dit Yann, possède un rythme interne, qui détermine la floraison. Il n’existe pas de période de l’année où l’on n’observe pas de floraison. La floraison correspond parfois aux étapes de croissance, mais semble également dépendre d’un rythme externe, climatique. Chez certaines espèces, tous les individus fleurissent en même temps, mais pour la plupart, la floraison est étalée sur toute l’année. Ces rythmes combinés, ce rythme multiple, c’est le rythme de l’arbre qui s’épanouit jusqu’à l’éblouissement.
Hélène regardait Yann, méfiante. Le rythme de l’arbre qui s’épanouit jusqu’à l’éblouissement. Avait-elle pensé en même temps, avant ou après lui? Elle ne dit rien, lui laissant le privilège du discours. Yann continuait, il lui expliquait maintenant la différence entre Nepenthes ampullaria, Nepenthes rafflesiana, Nepenthes gracilis, Nepenthes rajah, qu’Hélène avait bien reconnue sur le mont Kinabalu, Nepenthes albomarginata, Nepenthes sanguinea, Nepenthes hirsuta, Nepenthes stenophylla, Nepenthes tentaculata, Nepenthes villosa, ou Nepenthes campanulata.
– Sais-tu, dit Yann, ce que veut dire le mot Nepenthes?
– Tasse de thé, proposa Hélène.
– Presque, dit Yann, cela veut dire en grec : «qui dissipe la douleur, l’ennui ». À Bornéo, on en trouve près de 30 espèces. Le contenu des urnes dissipe la soif du voyageur exténué.
– Est-ce bien raisonnable de boire cette eau-là ? demanda Hélène.
– Oui, dit Yann, tu peux la boire. Hélène doutait. Son discours lui semblait quelque peu trop assuré. Yann expliquait que les Nepenthes poussaient sur les sols pauvres et trouvaient les nutriments dans les proies qu’ils attrapaient. Hélène avait bien compris cela. C’était très simple à comprendre, cela allait de soi. Si les plantes cherchent à se nourrir hors du sol, c’est que dans le sol il n’y a rien à manger. «Logique, se dit Hélène.» Et Yann continua sur les insectes qui vivaient en symbiose avec les Nepenthes. Hélène lui demanda alors de se taire. Elle était fatiguée. Le discours de Yann la fatiguait. Le discours de Yann ne lui donnait que des informations sans valeur absolue. Les Nepenthes existaient bien avant que nul n’ait l’idée de les nommer Nepenthes. Le fait qu’un bavard ait décidé un jour de les nommer n’avait pour rien au monde la moindre incidence ni sur leur existence, ni sur le fait que d’autres, avant, se soient arrêtés pour s’y désaltérer.
Sans la forêt, pas de forêt
– Non seulement la forêt ne dépend que d’elle-même, mais elle se protège elle-même. La moindre trouée permet aux précipitations ravageuses de tout emporter sur leur passage et la couche de sol si mince est immédiatement lessivée. Le soleil alors brûle tout ce qui reste. L’épaisse végétation de la forêt, par contre, filtre l’eau de pluie, la distribue et protège le sol de l’érosion. Les racines agissent comme des éponges qui libèrent l’eau progressivement.
– Sans la forêt, pas de forêt! déclara Hélène.
– C’est cela, dit Marianne, sans la forêt, pas de forêt. Et la disparition de la forêt provoque inondations et sécheresse. Un vrai désastre !